0%
Les origines du christianisme
l'index
Rechercher
Les origines du christianisme
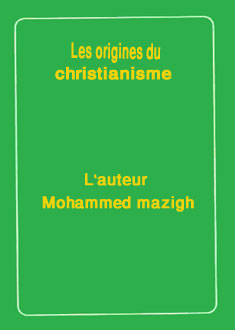 Auteur: Mohammed mazigh
Auteur: Mohammed mazigh
Catégorie:
visites: 3839
Télécharger: 193
-
Introduction
-
I- De l'Evangile céleste aux Evangiles terrestres
-
A- La notion de révélation et sa transmission dans le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam.
-
B-De l'Evangile céleste aux Evangiles terrestres
-
C-Les Evangiles canoniques
-
1- datation
-
2- la langue des Evangiles
-
3- les Evangiles synoptiques
-
4- l'Evangile de Matthieu
-
5- l'Evangile de Marc
-
6- l'Evangile de Luc
-
7- la singularité de l'Evangile de Jean
-
8- les Actes des Apôtres et les Epîtres
-
9- l'Apocalypse de Jean
-
10- Et si on comparaît les recensions de l'Evangile avec celle du Coran ?
-
D-Les contradictions des Evangiles
-
1- généalogie de Jésus
-
2- lieu de naissance de Jésus
-
3- naissance de Jésus
-
4-les rois mages
-
5- le massacre des innocents et la fuite en Egypte
-
6- Les premiers disciples
-
7- A propos de Jean-Baptiste
-
8-Jésus portant témoignage sur lui-même
-
9-aveugles, fous et…ânesses : combien ?
-
10-cananéenne ou grecque d'origine syro-phénicienne ?
-
11-la trahison de Judas
-
12-l'arrestation
-
13 date de la crucifixion
-
14- le port de la croix
-
15-les co-condamnés
-
16-les derniers propos de Jésus
-
117-le témoignage du centenier
-
18-l'heure présumée de la mort
-
19-l'ensevelissement
-
20-la fin de Judas
-
21-la résurrection
-
Introduction
-
Apocalypses
-
1-l'Evangile de Pierre
-
2-L'Evangile de Judas
-
3-Protoévangile de Jacques
-
4-l'Evangile de Thomas
-
5-l'Evangile arabe de l'Enfance
-
7-l'Evangile de Barnabé
-
A-La vie de Jésus
-
1-Jésus a-t-il existé ?
-
2-le nom de Jésus
-
3-généalogie de Jésus
-
4-date de naissance de Jésus
-
5-Marie, mère de Jésus
-
6-la naissance miraculeuse
-
8-les ''frères'' et ''soeurs'' de Jésus
-
9-l'enfance et la jeunesse de Jésus
-
10-la prédication de Jean
-
11-la tentation
-
12-la prédication de Jésus
-
13-aspect extérieur et tempérament
-
14-les miracles
-
Le Coran aussi cite des miracles de Jésus
-
15-les Apôtres
-
16- à Jérusalem
-
17-l'incident du Temple
-
18-le dernier repas
-
19-la trahison de Judas
-
20-l'arrestation
-
21-le procès
-
22-la fin de Jésus
-
23-le Coran et la crucifixion
-
24-la résurrection
-
25-l'ascension
-
III L'enseignement de Jésus
-
A-Jésus et le judaïsme
-
D-la question des logia
-
B-sentences et paraboles
-
C-les sentences
-
E-les paraboles
-
F-le contenu de l'enseignement
-
G-le Royaume de Dieu
-
H-principes moraux
-
IV Prophète, Messie, Fils de l'Homme ou Fils de Dieu ?
-
A-le titre véritable : le prophète
-
B-Le titre confirmé : le Messie
-
C-le titre énigmatique : le Fils de l'Homme
-
D-Le titre mensonger : le Fils de Dieu
-
V Jésus a-t-il annoncé le Prophète Mohammed ?
-
A-L'annonce du Prophète Mohammed dans les Evangiles
-
B-L'annonce du Prophète Mohammed dans l'Ancien Testament
-
VI Les origines du christianisme
-
A-introduction
-
B-Les premières communautés
-
1-La religion de Jésus
-
2-Jésus et l'essénisme
-
3-Les croyants en Jésus
-
4-Les Hellénistes
-
5-Pratiques cultuelles et doctrine
-
C-Survivance de communautés de croyants en Jésus
-
1-les Nazaréens
-
2-Les Ebionites
-
D-Le terrain hellénique
-
1-la philosophie
-
2-les religions
-
3-les religions à mystères
-
4-le mystère de Mithra
-
5-le mystère d'Orphée
-
6-le mystère d'Isis
-
E-Paul de Tarse, fondateur du christianisme :
-
1-Tarse
-
2-Les origines
-
3-Formation intellectuelle et influences
-
4-Du juif persécuteur de chrétiens au chrétien zélé
-
5-L'Apôtre et le missionnaire
-
6-La prédication paulinienne
-
7-Les voyages apostoliques
-
8-La pensée de Paul
-
9-Conclusion
-
VII L'invention du christianisme
-
A-Le christianisme : de la persécution au triomphe
-
1-Persécution et périodes de tolérance
-
2-Le triomphe
-
3-La mythisation
-
4-La date de naissance du Christ
-
5-Les mages et l'adoration du Nouveau Mithra
-
6-La crucifixion et la résurrection
-
7-Le culte de la croix
-
8-La trinité ou le polythéisme déguisé en monothéisme
-
9-La mère de Dieu ou la mère du dieu ?
-
10-Le péché originel
-
11-L'islam et le péché originel
-
12-La rédemption
-
13-L'incarnation
-
14-Le baptême
-
14-L'eucharistie
-
VIII Les crimes de l'Eglise
-
A-Hérésies
-
1-le donatisme
-
2-l'hérésie arienne
-
3-le monophysisme
-
4-les Pauliciens
-
5-l'hérésie bogomile
-
6-les Cathares et la croisade contre les Albigeois
-
7-les amauriciens
-
B-Les croisades
-
1-La prise de Jérusalem
-
2-Les appels aux massacres
-
C-L'inquisition
-
D-Le massacre des musulmans d'Espagne et la croisade africaine
-
1-L'esclavage
-
2-Le colonialisme
-
E-Les crimes contre les savants et la science
-
3-Michel Servet
-
4-Giordano Bruno
-
5-Galilée
-
6-La chasse aux sorcières
-
2-Le colonialisme
-
1-Monothéisme juif, chrétien et musulman
-
IX Conclusions
-
X ANNEXES
-
B-Jésus dans les Evangiles apocryphes
-
1-Naissance de Jésus
-
2-Les enfances de Jésus (voir Migne, 1140
-
3--des miracles de Jésus enfant
-
4-Jésus dans le Temple
-
5-Extraits de l'Evangile de Barnabé
-
a-Prologue
-
b-L'annonce faite à Marie
-
c-Révélation de l'Evangile et début du ministère de Jésus
-
d-Premier sermon de Jésus
-
e- l'infidélité des chrétiens et la vraie foi du croyant
-
f-Origine de la circoncision; damnation des incirconcis
-
h-Jésus annonce la fin du monde
-
i-Où Jésus proclame qu'il est un mortel
-
g-le pourvoir accordé aux apôtres
-
k-Jésus et les divinités romaines
-
L-Jésus annonce le Prophète Mohammed
-
m-les juifs complotent contre Jésus
-
n-la trahison de Judas
-
p-sur la pseudo résurrection
-
q-Jésus rétabli la vérité
-
r-l'ascension de Jésus
-
C-Jésus dans le Coran
-
1-Les noms de Jésus dans le Coran
-
2-Qualité de Jésus
-
3-Marie, mère de Jésus
-
4-Marie en retraite
-
5-la conception et la naissance de Jésus
-
6-Un prédécesseur : Jean fils de Zacharie
-
7-Prédication de Jésus
-
8-les miracles
-
9-l'annonce du Prophète Mohammed
-
10-la fin de Jésus
-
11-contre la divinité de Jésus
-
12-Le retour de Jésus pour annoncer la fin du monde
-
Bibliographie
-
Textes religieux
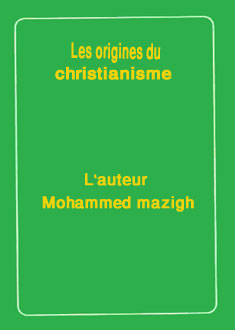
Les origines du christianisme
Auteur: Mohammed mazighFrançais