0%
La Bible, le Coran et la science
l'index
Rechercher
La Bible, le Coran et la science
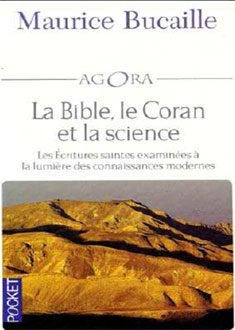 Auteur: MAURICE BUCAILLE
Auteur: MAURICE BUCAILLE
Catégorie:
visites: 3484
Télécharger: 132
-
AVANT-PROPOS
-
Les points de vue des exégètes sont sans équivoque.
-
Des conséquences évaluables aujourd'hui résultent de cet état de choses.
-
INTRODUCTION
-
L'ANCIEN TESTAMENT.
-
APERéU GéNéRAL
-
LES LIVRES DE L'ANCIEN TESTAMENT
-
La Torah ou Pentateuque
-
DéTAIL DE LA RéPARTITION DU TEXTE YAHVISTE ET DU TEXTE SACERDOTAL DANS LES
-
CHAPITRES 1 A 11 DE LA GENéSE
-
Les livres historiques
-
Les livres prophétiques
-
Les livres poétiques et de sagesse
-
III L'ANCIEN TESTAMENT ET
-
LA SCIENCE MODERNE.
-
CONSTATATIONS
-
La création du monde
-
PREMIER RECIT DE LA CREATION
-
L'Ancien Testament et la science moderne
-
Ce passage contient des assertions inacceptables.
-
Ce récit du septième jour appelle des commentaires.
-
DEUXIEME RECIT
-
Date de la création du monde et date de l'apparition de l'homme sur la terre
-
2. D'ABRAHAM A L'ERE CHRETIENNE.
-
Le Déluge
-
Le récit est, dans son ensemble, le suivant :
-
IV. POSITION DES AUTEURS CHRETIENS DEVANT LES ERREURS SCIENTIFIQUES DES TEXTES BIBLIQUES.
-
LEUR EXAMEN CRITIQUE
-
CONCLUSIONS
-
LES EVANGILES
-
INTRODUCTION
-
RAPPEL HISTORIQUE.
-
LE JUDEO-CHRISTIANISME ET SAINT PAUL
-
LES QUATRE EVANGILES. LEURS SOURCES.
-
LEUR HISTOIRE
-
Evangile selon Matthieu
-
Evangile de Marc
-
Evangile de Luc
-
Evangile de Jean
-
Les sources des Evangiles
-
Le document C a inspiré Marc, Luc et Jean.
-
M.-E. BOISMARD
-
SYNOPSE DES QUATRE EVANGILES
-
Histoire des textes
-
LES EVANGILES ET LA SCIENCE MODERNE. LES GENEALOGIES DE JESUS
-
Les généalogies de Jésus
-
LIVRE DES ORIGINES DE JESUS-CHRIST, FILS DE DAVID, FILS D'ABRAHAM
-
GENEALOGIB DE JESUS, AVANT DAVID
-
Les généalogies de Jésus
-
GENEALOGIE Selon Matthieu
-
Déportation à Babylone
-
DE JESUS, APRES DAVID
-
VARIATIONS SELON LES MANUSCRITS ET PAR RAPPORT A L'ANCIEN TESTAMENT
-
1. PERIODE D'ADAM A ABRAHAM
-
2. PERIODE D'ABRAHAM A DAVID
-
3. PERIODE POSTERIEURE A DAVID
-
Commentaires d'exégètes modernes
-
CONTRADICTIONS ET INVRAISEMBLANCES DES RECITS
-
Les récits de la Passion
-
L'absence dans l'Evangile de Jean du récit de l'institution de l'Eucharistie
-
Apparitions de Jésus ressuscité
-
La contradiction entre Paul, seul témoin oculaire mais suspect, et les Evangiles est patente.
-
L'Ascension de Jésus
-
Contradictions et invraisemblances des récits
-
Les derniers entretiens de Jésus. Le Paraclet de l'Evangile de Jean
-
Evangiles
-
Contradictions et invraisemblances des récits
-
Contradictions et invraisemblances des récits
-
VI. CONCLUSIONS
-
Le Coran et la science moderne
-
I. INTRODUCTION
-
Musulmans et chrétiens adorent un Dieu unique.
-
II. AUTHENTICITE DU CORAN ET HISTOIRE DE SA REDACTION
-
III. LA CREATION DES CIEUX ET DE LA TERRE
-
Le Coran et la science moderne
-
III. LA CREATION DES CIEUX ET DE LA TERRE
-
Différences et analogies avec le récit biblique
-
LES SIX PERIODES DE LA CREATION
-
Le Coran et la science moderne
-
Quelques données de la science moderne sur la formation de l'univers en comparaison avec le Coran
-
LE SYSTEME SOLAIRE
-
LES GALAXIES
-
FORMATION ET EVOLUTION DES GALAXIES, DES ETOILES ET DES SYSTEMES PLANETAIRES
-
LE CONCEPT DE PLURALITE DES MONDES
-
LA MATIERE INTERSTELLAIRE
-
Confrontation avec les données coraniques sur la création
-
Réponses à certaines objections
-
IV. L'ASTRONOMIE DANS LE CORAN
-
A. Réflexions générales sur le ciel
-
B. Nature des corps célestes
-
LE SOLEIL ET LA LUNE
-
LES ETOILES
-
LES PLANETES
-
LE CIEL LE- PLUS PROCHE
-
L'EXISTENCE D'ORBITES POUR LA LUNE ET LE SOLEIL
-
L'ALLUSION AU DEPLACEMENT DE LA LUNE ET DU SOLEIL DANS L'ESPACE AVEC UN MOUVEMENT PROPRE
-
LA SUCCESSION DES JOURS ET DES NUITS
-
L' EXPANSION DE L UNIVERS
-
L'astronomie dans le Coran
-
V. LA TERRE
-
A. Versets de portée générale
-
B. Le cycle de l'eau et les mers
-
LES MERS
-
C. Le relief terrestre
-
D. L'atmosphère terrestre
-
L'ALTITUDE
-
L'ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE
-
L'OMBRE
-
VI. REGNES VEGETAL ET ANIMAL
-
A. L'ORIGINE DE LA VIE:
-
B. Le règne végétal
-
L'EQUILIBRE REGNANT DANS LE REGNE VEGETAL
-
LA DIFFERENCIATION DES NOURRITURES
-
REPRODUCTION DES VEGETAUX
-
C. Le règne animal
-
1. REPRODUCTION DANS LE REGNE ANIMAL
-
LES MERS
-
2. EXISTENCE DE COMMUNAUTES ANIMALES
-
3. REFLEXIONS CONCERNANT LES ABEILLES, LES ARAIGNEES ET LES OISEAUX
-
L'abeille
-
L'araignée
-
Les oiseaux
-
4. PROVENANCE DES CONSTITUANTS DU LAIT ANIMAL
-
VII. REPRODUCTION HUMAINE
-
Rappel de certaines notions
-
La reproduction humaine dans le Coran
-
1. LA FECONDATION S'OPERE GRACE A UN TRES PETIT VOLUME DE LIQUIDE
-
2. LA NATURE DU LIQUIDE FECONDANT
-
3. LA NIDATION DE L'OEUF DANS L'APPAREIL GENITAL FEMININ
-
4. L'EVOLUTION DE L'EMBRYON A L'INTERIEUR DE L'UTERUS
-
Coran et éducation sexuelle
-
Récits coraniques et récits bibliques
-
I. APERçU GENERAL
-
II LE DELUGE
-
Les arguments à l'appui de ce jugement sont les suivants.
-
Le récit coranique du Déluge
-
III. L'EXODE DE MOïSE
-
1. EXAMEN DE CERTAINS DETAILS DES RECITS
-
Les Hébreux en Egypte
-
Les plaies d'Egypte
-
L'itinéraire de l'Exode
-
Le miracle de la mer
-
2. SITUATION DE L'EXODE DANS LA CHRONOLOGIE PHARAONIQUE
-
3. RAMSèS II, PHARAON DE L'OPPRESSION MINEPTAH, PHARAON DE L'EXODE
-
Le problème de la stèle de l'an V de Mineptah
-
4. L'EVOCATION PAR LES ECRITURES SAINTES DE LA MORT DU PHARAON LORS DE L'EXODE
-
Coran, Hadiths et science moderne
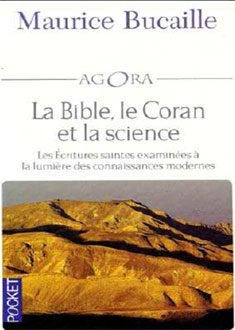
La Bible, le Coran et la science
Auteur: MAURICE BUCAILLEFrançais